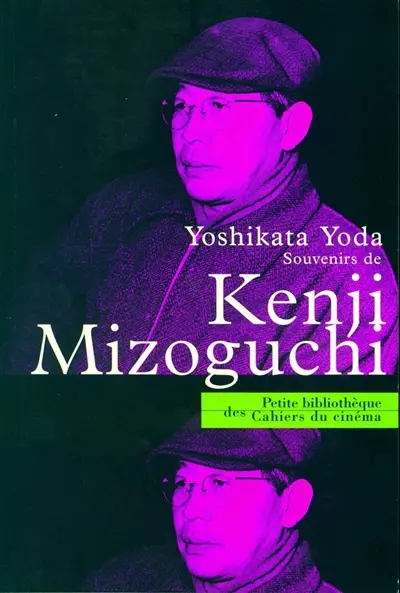Chargement...
Chargement...
Le Dit de Mizoguchi

Une actualité de
Julien
Publié le
16/12/2017
Réception, en léger différé, d'un bel ouvrage consacré au cinéaste japonais Kenji Mizoguchi, salvatrice oasis dans un désert éditorial.
Il est une façon aisée, et un peu cavalière, d'appréhender le quatuor magique du cinéma japonais : Ozu fut le cinéaste de la famille, Naruse celui du couple, Kurosawa celui de l'homme et enfin Mizoguchi, de toute évidence, celui de la femme. Car s'il est un cinéaste qui, parmi tous, échappe à ce que Truffaut appelait "la tristesse infinie des films sans femmes" c'est bien Mizoguchi.
A ce sujet, gardons-nous de tout malentendu : le cinéaste est loin d'un regard compassé et de ces films à perspective ornementale ou cosmétique dans lesquels les personnages féminins, pour seule étoffe psychologique, ont le luxe du choix entre deux prétendants. Aliénées, trahies, humiliées par les hommes, souvent promises à un sort funeste, les héroïnes de Mizoguchi, loin de se résigner, se révèlent dans l'adversité et dépassent leur statut de victimes expiatoires. La mosaïque de portraits féminins qui constitue la pierre angulaire de sa filmographie n'a aucun équivalent dans l'histoire du cinéma.
L'ouvrage que lui consacre Daniel Chocron met en relief les faits les plus saillants de sa biographie, qui ont probablement orienté le sens de l’œuvre à venir : le jeune Mizoguchi ne s'est jamais vraiment remis de la vente de sa grande sœur comme geisha, suite à la déroute financière du pater familias (dans ses films, les figures paternelles seront rarement épargnées...). Cette même sœur qui, pendant longtemps, aidera financièrement le jeune acteur et aspirant metteur en scène. De cet entrelac de relations complexes, sinon viciées, découle certainement la profusion de films décrivant le monde des geishas, voire la prostitution la plus crue (ainsi de son dernier opus La rue de la honte). Cela peut expliquer de même que l'attention continue, obsessionnelle, au sort des femmes s'accompagne chez Mizoguchi d'une observation plus globale de tous les résidus de féodalisme dans la société japonaise et de la perversité de tous les rapports d'exploitations, de classes ou de genres. On a peine à croire que le cinéaste - qui par ailleurs fut poignardé par une amante, sans en nourrir pour autant le moindre ressentiment à l'encontre de la gent féminine - fit ses débuts dans un cinéma dont les femmes, dans la tradition du théâtre kabuki, étaient exclues et leurs rôles interprétés par des acteurs masculins (les oyama). Il participa à la fronde contre cet état de fait, et par la suite, avec un talent inné pour la direction d'actrices, rattrapa presque à lui seul tout le retard... A cet égard, L'Amour de l'actrice Sumako, vibrant portrait d'une actrice de théâtre au caractère bien trempé et aux choix forts (Carmen, Nora...), apparaît comme un magnifique plaidoyer.
Son œuvre, telle que nous pouvons la connaître (1), est amoureusement abordée tout au long de l'ouvrage (l'auteur a de tels yeux de Chimène pour son sujet qu'on pourrait le jalouser). Après s'être affranchie des influences américaines (Lubitsch en premier lieu) elle connut un premier essor au milieu des années 30 (L’Élégie d'Osaka, Les Sœurs de Gion) avant d'être contrariée par la dictature militaire et la mise sous tutelle du cinéma japonais. Mizoguchi, en porte-à-faux avec les valeurs viriles exaltées par le régime, s'acquittera alors sans enthousiasme de quelques films de circonstance, n'ayant pas encore la stature d'un Ozu qui put s'octroyer le loisir de rester superbement improductif pendant la même période. Que dans ses films historiques, l'ère Meiji - celle de l'ouverture - soit sa période de prédilection ne relève pas du hasard ou de l'afféterie. Ce tropisme se double logiquement d'une grande connaissance de la littérature occidentale (bien que la majorité de ses sujets soient endogènes, il s'inspira de Boule de suif pour Oyuki la vierge, devançant John Ford et sa Chevauchée fantastique).
Au sortir de la guerre, à nouveau souverain dans le choix de ses scénarios, il signe une série de films crus et désespérés sous perfusion rossellinienne, dépeignant la condition féminine sans fard (Flamme de mon amour, Femmes de la nuit), dans lesquels le ton devient frontalement féministe. Ce quasi-militantisme s'accompagne d'une noirceur, d'un pessimisme, d'une dureté sans commune mesure : Mizoguchi est aussi un prince de la cruauté. Les fins tragiques de ses films (2), loin du tire-larme à l'italienne (soulignons qu'il n'est que très rarement question d'enfants, cette arme de destruction massive du mélo), sont plutôt des appels, voire des défis, à la conscience du spectateur, que ce soit à l'occasion d'un double-suicide d’amants réprouvés ou du regard-caméra d'une prostituée assumant pleinement ses choix. Ce cinéaste des sommets (comme épitaphe, son producteur fit simplement graver "le plus grand cinéaste du monde"), juché sur sa ligne de crête, manque parfois de peu de basculer dans le versant du dolorisme, notamment par un certain masochisme dans la détestation de son genre : ainsi le regard porté sur ses personnages masculins, leur intransigeance ou pusillanimité selon les circonstances, manque parfois de nuances.
Au mitan des années 50, Mizoguchi a certainement atteint son zénith dans une ultime série de films, les plus connus et célébrés (Les Contes de la lune vague après la pluie, Les amants crucifiés, L'Intendant Sansho, etc.), qui, par l'entremise des festivals, attirèrent l'attention du public occidental, juste à temps avant la mort prématurée du cinéaste en 1956. Mizoguchi y a trouvé le point d'équilibre entre son exigence de vérité et le soin accordé à la mise en scène (fluidité, perfection des cadrages, économie des effets confinant à l'épure, ainsi que le temps de deux films seulement, une appropriation heureuse de la couleur). Cette fin de carrière, sans doute la plus flamboyante du cinéma, supernova filmique qui n'a toujours pas cessé d'irradier, fait ici l'objet des commentaires les plus passionnés et des analyses les plus détaillées de la part de Daniel Chocron, irrésistible invitation à se replonger dans ces merveilles.
Pour enfin extraire Mizoguchi hors du sinistre purgatoire des "cinéastes pour cinéphiles", l'initiative de l'éditeur et la belle synthèse effectuée par l'auteur sont plus que méritoires. Au sein d'une bibliographie guère florissante (comme en vidéo, le cinéma de patrimoine japonais fait hélas figure de chat noir commercial), on pourra prolonger le plaisir avec les Souvenirs de Kenji Mizoguchi de son scénariste et ami Yoshikata Yoda - où la description du travail méticuleux, obsessionnel, intransigeant de "Mizo-san" sur ses scénarios et mises en scène s'accompagne, en creux, d'un beau témoignage sur l'amitié masculine - et aussi se reporter avec profit aux notules admirables que lui a consacré Jacques Lourcelles dans son insubmersible Dictionnaire des films.
Notes :
(1) Mizoguchi est, selon les jours, l'auteur de 88, 90, 94 ou 96 films... les estimations divergent. Toujours est-il que tremblements de terre et bombardements de la Seconde Guerre ont uni leurs forces pour engloutir une grande partie de l’œuvre. Par conséquent, Mizoguchi a, parmi les géants du cinéma, le triste privilège d'être celui dont le plus de films ont été perdus : les deux-tiers de sa filmographie, dont la quasi-totalité de l’œuvre muette.
(2) A toutes fins utiles - et en toute objectivité - rappelons que la séquence finale de L'Impératrice Yang Kwei-Fei est la plus belle de toute l'histoire du cinéma.
A ce sujet, gardons-nous de tout malentendu : le cinéaste est loin d'un regard compassé et de ces films à perspective ornementale ou cosmétique dans lesquels les personnages féminins, pour seule étoffe psychologique, ont le luxe du choix entre deux prétendants. Aliénées, trahies, humiliées par les hommes, souvent promises à un sort funeste, les héroïnes de Mizoguchi, loin de se résigner, se révèlent dans l'adversité et dépassent leur statut de victimes expiatoires. La mosaïque de portraits féminins qui constitue la pierre angulaire de sa filmographie n'a aucun équivalent dans l'histoire du cinéma.
L'ouvrage que lui consacre Daniel Chocron met en relief les faits les plus saillants de sa biographie, qui ont probablement orienté le sens de l’œuvre à venir : le jeune Mizoguchi ne s'est jamais vraiment remis de la vente de sa grande sœur comme geisha, suite à la déroute financière du pater familias (dans ses films, les figures paternelles seront rarement épargnées...). Cette même sœur qui, pendant longtemps, aidera financièrement le jeune acteur et aspirant metteur en scène. De cet entrelac de relations complexes, sinon viciées, découle certainement la profusion de films décrivant le monde des geishas, voire la prostitution la plus crue (ainsi de son dernier opus La rue de la honte). Cela peut expliquer de même que l'attention continue, obsessionnelle, au sort des femmes s'accompagne chez Mizoguchi d'une observation plus globale de tous les résidus de féodalisme dans la société japonaise et de la perversité de tous les rapports d'exploitations, de classes ou de genres. On a peine à croire que le cinéaste - qui par ailleurs fut poignardé par une amante, sans en nourrir pour autant le moindre ressentiment à l'encontre de la gent féminine - fit ses débuts dans un cinéma dont les femmes, dans la tradition du théâtre kabuki, étaient exclues et leurs rôles interprétés par des acteurs masculins (les oyama). Il participa à la fronde contre cet état de fait, et par la suite, avec un talent inné pour la direction d'actrices, rattrapa presque à lui seul tout le retard... A cet égard, L'Amour de l'actrice Sumako, vibrant portrait d'une actrice de théâtre au caractère bien trempé et aux choix forts (Carmen, Nora...), apparaît comme un magnifique plaidoyer.
Son œuvre, telle que nous pouvons la connaître (1), est amoureusement abordée tout au long de l'ouvrage (l'auteur a de tels yeux de Chimène pour son sujet qu'on pourrait le jalouser). Après s'être affranchie des influences américaines (Lubitsch en premier lieu) elle connut un premier essor au milieu des années 30 (L’Élégie d'Osaka, Les Sœurs de Gion) avant d'être contrariée par la dictature militaire et la mise sous tutelle du cinéma japonais. Mizoguchi, en porte-à-faux avec les valeurs viriles exaltées par le régime, s'acquittera alors sans enthousiasme de quelques films de circonstance, n'ayant pas encore la stature d'un Ozu qui put s'octroyer le loisir de rester superbement improductif pendant la même période. Que dans ses films historiques, l'ère Meiji - celle de l'ouverture - soit sa période de prédilection ne relève pas du hasard ou de l'afféterie. Ce tropisme se double logiquement d'une grande connaissance de la littérature occidentale (bien que la majorité de ses sujets soient endogènes, il s'inspira de Boule de suif pour Oyuki la vierge, devançant John Ford et sa Chevauchée fantastique).
Au sortir de la guerre, à nouveau souverain dans le choix de ses scénarios, il signe une série de films crus et désespérés sous perfusion rossellinienne, dépeignant la condition féminine sans fard (Flamme de mon amour, Femmes de la nuit), dans lesquels le ton devient frontalement féministe. Ce quasi-militantisme s'accompagne d'une noirceur, d'un pessimisme, d'une dureté sans commune mesure : Mizoguchi est aussi un prince de la cruauté. Les fins tragiques de ses films (2), loin du tire-larme à l'italienne (soulignons qu'il n'est que très rarement question d'enfants, cette arme de destruction massive du mélo), sont plutôt des appels, voire des défis, à la conscience du spectateur, que ce soit à l'occasion d'un double-suicide d’amants réprouvés ou du regard-caméra d'une prostituée assumant pleinement ses choix. Ce cinéaste des sommets (comme épitaphe, son producteur fit simplement graver "le plus grand cinéaste du monde"), juché sur sa ligne de crête, manque parfois de peu de basculer dans le versant du dolorisme, notamment par un certain masochisme dans la détestation de son genre : ainsi le regard porté sur ses personnages masculins, leur intransigeance ou pusillanimité selon les circonstances, manque parfois de nuances.
Au mitan des années 50, Mizoguchi a certainement atteint son zénith dans une ultime série de films, les plus connus et célébrés (Les Contes de la lune vague après la pluie, Les amants crucifiés, L'Intendant Sansho, etc.), qui, par l'entremise des festivals, attirèrent l'attention du public occidental, juste à temps avant la mort prématurée du cinéaste en 1956. Mizoguchi y a trouvé le point d'équilibre entre son exigence de vérité et le soin accordé à la mise en scène (fluidité, perfection des cadrages, économie des effets confinant à l'épure, ainsi que le temps de deux films seulement, une appropriation heureuse de la couleur). Cette fin de carrière, sans doute la plus flamboyante du cinéma, supernova filmique qui n'a toujours pas cessé d'irradier, fait ici l'objet des commentaires les plus passionnés et des analyses les plus détaillées de la part de Daniel Chocron, irrésistible invitation à se replonger dans ces merveilles.
Pour enfin extraire Mizoguchi hors du sinistre purgatoire des "cinéastes pour cinéphiles", l'initiative de l'éditeur et la belle synthèse effectuée par l'auteur sont plus que méritoires. Au sein d'une bibliographie guère florissante (comme en vidéo, le cinéma de patrimoine japonais fait hélas figure de chat noir commercial), on pourra prolonger le plaisir avec les Souvenirs de Kenji Mizoguchi de son scénariste et ami Yoshikata Yoda - où la description du travail méticuleux, obsessionnel, intransigeant de "Mizo-san" sur ses scénarios et mises en scène s'accompagne, en creux, d'un beau témoignage sur l'amitié masculine - et aussi se reporter avec profit aux notules admirables que lui a consacré Jacques Lourcelles dans son insubmersible Dictionnaire des films.
Notes :
(1) Mizoguchi est, selon les jours, l'auteur de 88, 90, 94 ou 96 films... les estimations divergent. Toujours est-il que tremblements de terre et bombardements de la Seconde Guerre ont uni leurs forces pour engloutir une grande partie de l’œuvre. Par conséquent, Mizoguchi a, parmi les géants du cinéma, le triste privilège d'être celui dont le plus de films ont été perdus : les deux-tiers de sa filmographie, dont la quasi-totalité de l’œuvre muette.
(2) A toutes fins utiles - et en toute objectivité - rappelons que la séquence finale de L'Impératrice Yang Kwei-Fei est la plus belle de toute l'histoire du cinéma.
Bibliographie