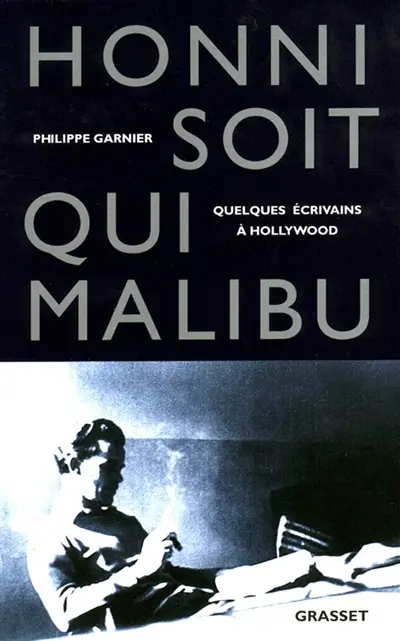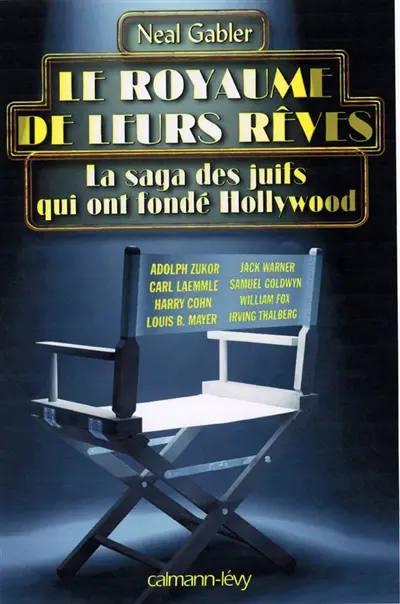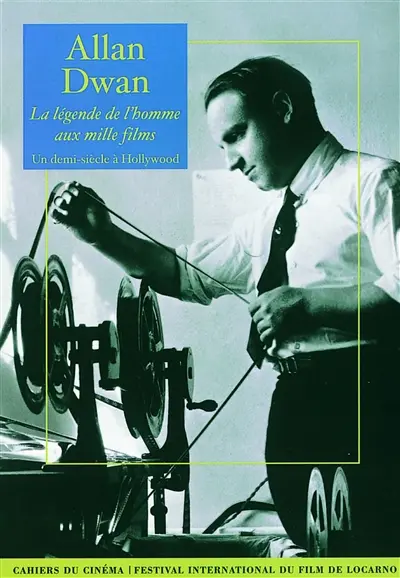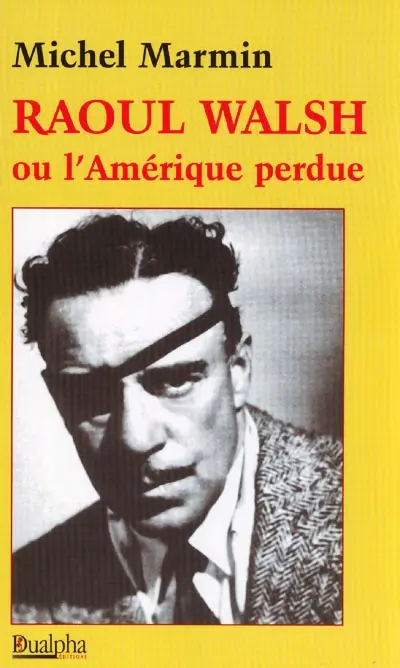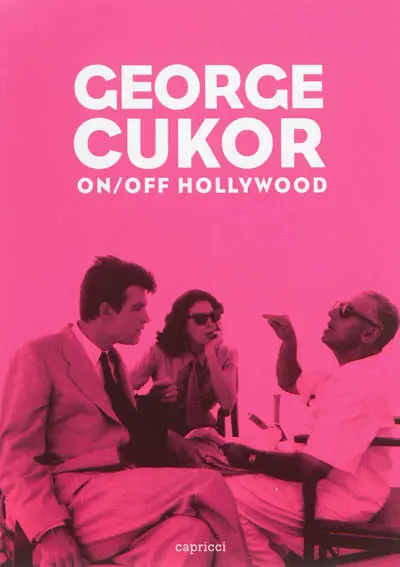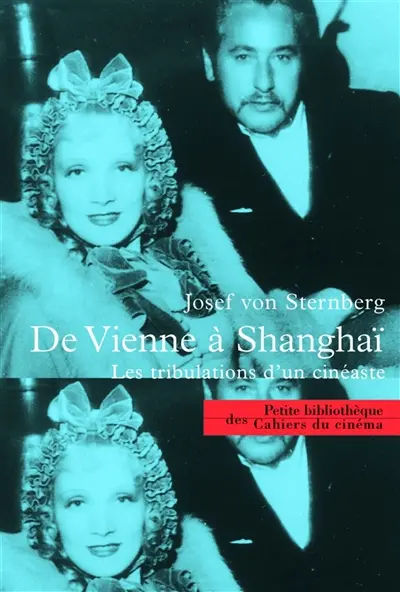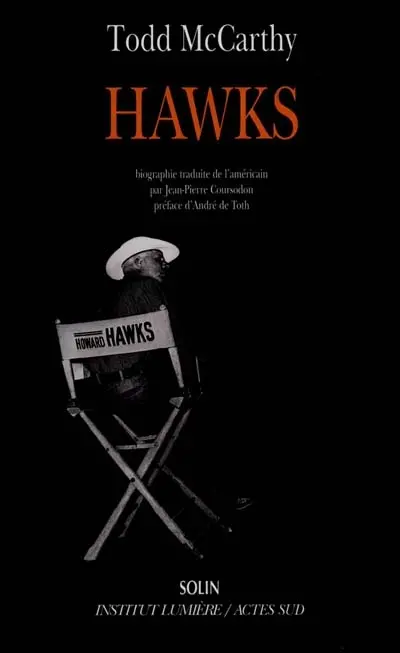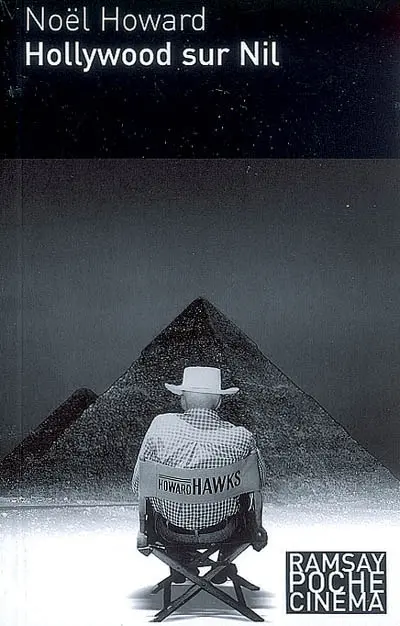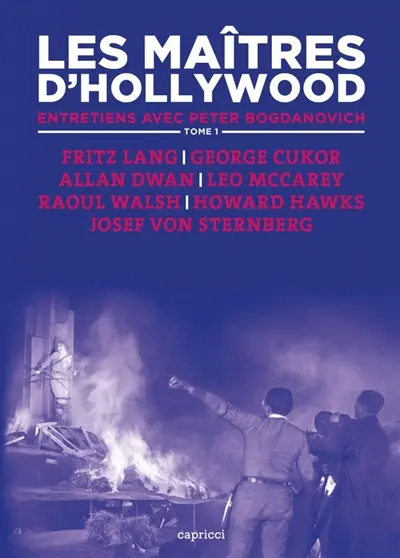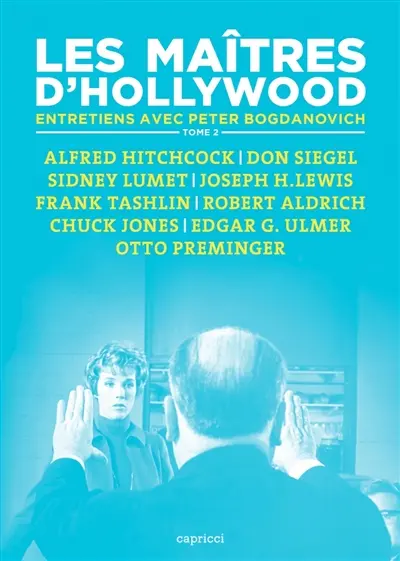Chargement...
Chargement...
Les maîtres d'Hollywood

Une actualité de
Julien
Publié le
14/02/2018
Dwan, Walsh, Lang, Sternberg, Hawks, McCarey, Cukor : pour définir les contours du cinéma classique américain, Peter Bogdanovich a réuni un aréopage qui a fière allure.
Longtemps repoussée, cette arlésienne est enfin parvenue entre nos mains. Il arrive qu'un retard soit annonciateur d'un heureux événement : ainsi un "tome 1" est apparu sur la couverture, comme une promesse pour le futur...
A l'instar de la nouvelle vague en France, Bogdanovich est emblématique de cette génération de cinéastes, la première qui fut maladivement cinéphile avant de passer à la mise en scène et pour laquelle une précoce carrière en cinéphilie a été la seule école de cinéma. Tout au long des années 60, il s'incrusta sur tous les tournages, harcela tous ses metteurs de scène de prédilection, avide de recueillir leurs souvenirs, conseils et secrets de fabrication. Il parvint à obtenir leur confiance, et parfois leur amitié. De cette position privilégiée et au fil de conversations souvent étalées sur plusieurs années - ce qui lui évita les spéculations et délires d’interprétation de la lointaine mais dominante critique française -, il tira un corpus d'entretiens qui s'est imposé comme une contribution majeure à l'histoire du cinéma américain.
Cela n'alla pas sans heurts. Dans la clinique du Dr Bogdanovich, certains patients étaient réticents à toute psychanalyse. Ils étaient arrivés dans le cinéma par hasard, par opportunité, par goût de l'aventure, mus par l'esprit des pionniers qui animait encore leur génération. Qu'on puisse décortiquer leurs films, et les interroger à ce propos, les dépassait totalement. Leur degré d'attachement à tel ou tel de leur bébé - en façade du moins - ne pouvait se mesurer qu'à l'aune de leur succès commercial. Ford était redoutable dans l'exercice et ne pouvait cacher ses origines irlandaises : il était donc généralement ivre, irascible, sentimental et terriblement attachant. Bogdanovich préféra lui consacrer un documentaire, Directed by John Ford. Walsh, dit-on, s'amusait à tremper son oeil de verre dans sa consommation pour faire fuir les curieux et importuns (sa cible privilégiée : les producteurs). D'autres, au contraire, étaient tellement conscients d'eux-mêmes qu'ils pouvaient atteindre des sommets dans l'affabulation, tel Welles devant un Bogdanovich médusé dans un autre livre fameux, Moi, Orson Welles. À ce sujet, on frémit à l'idée de pouvoir relire l'interview d'Edgar G. Ulmer - qui, à lui tout seul, parvint à réécrire une histoire parallèle du cinéma - dans le second tome à paraître...
C'est le prolixe Allan Dwan qui ouvre cette première livraison. Lui a tout connu, sauf la gloire : le muet, les films d'une ou deux bobines, le long-métrage, l'arrivée de la couleur puis du son, la chute des studios, le cinéma en deux dimensions, trois dimensions, voire sans dimensions du tout... Il a mis en boîte, au bas mot, 400 films (dont l'irrésistible Deux rouquines dans la bagarre, ce délice suprême qu'est le film-noir en couleurs). Avec son cursus d'éclairagiste et ses trouvailles improvisées sur le tas, il a contribué au cinéma en tant que technique et garni la boîte à outils de tous les cinéastes à venir. Et en matière d'art, en forçant les forteresses imprenables qu'étaient ses plateaux et épiant les tournages épiques qui s'y déroulaient, il a tout appris de D.W. Griffith, le Roi sans couronne dont chaque réalisateur, aujourd'hui comme hier, demeure le sujet.
Griffith, brisé, alcoolique, est mort dans l'indifférence générale et l'indigence en 1948. Nul doute que sans ce fâcheux contretemps il aurait été le tout premier maître vers lequel se serait tourné le jeune Bogdanovich dans ses années d'apprentissage. Tous les réalisateurs réunis ici confessent envers lui une dette jamais honorée. Dans son Naissance d'une nation, Raoul Walsh interprète le rôle de John Wilkes Booth, l'assassin de Lincoln. Un symbole parfait pour cet aventurier arrivé en Californie à cheval et qui, annonçant une oeuvre effrénée et tellurique, prit tous les risques pour aller filmer Pancho Villa en pleine action. Walsh avait déjà vécu mille vies avant d'en arriver au cinéma. Il en évoque quelques unes ici, avant de mettre un terme à la conversation pour galoper écrire ses mémoires (ce passage obligé de tout hollywoodien en pré-retraite, au titre français trompeur - Un demi-siècle à Hollywood -, reste à ce jour le plus divertissant écrit par un réalisateur, évitant soigneusement de parler de cinéma mais contenant la sève d'une douzaine de romans de London ou Stevenson.
Changement radical d'ambiance avec Fritz Lang, sans doute le réalisateur le plus détesté de ses pairs. Il est vrai qu'il cède peu au péché d'humilité et ne se livre guère à la galéjade... L'entretien nous le montre au comble de l'aigreur et de la solitude. Cela n'empêche en rien un regard lucide et acéré sur Hollywood et sa propre carrière. Aussi passionnant que déplaisant : en tout point fidèle à ses films. On peut partager ses réserves sur Metropolis (un film de "Madame von Harbou" : c'est ainsi qu'il se réfère systématiquement à son ancienne épouse et scénariste, qui finit par lui préférer le nazisme) et privilégier avec lui Les Trois lumières, M le maudit, Furie, Chasse à l'homme ou L'Invraisemblable vérité.
Demeure ce mystère : comment peut-il, ici comme ailleurs, faire si peu de cas dans sa filmographie des Contrebandiers de Moonfleet ? Est-ce parce qu'il fut contraint de le tourner en Cinémascope, "format qui n'est intéressant que pour filmer les serpents et les enterrements" ? Il n'y a plus que le concept glissant de chef d’œuvre involontaire qui puisse raccrocher cette sublime rêverie aux branches de la théorie auctoriale à la française.
Au demeurant, cette politique des auteurs développée par les Cahiers du cinéma, admirable dans ses intentions, reste dans le cadre du cinéma américain une pure chimère. S'appuyant sur une profonde connaissance du fonctionnement des studios, conscient comme Prévert qu'il n'y a rien de plus menteur qu'un générique, le grand atout de Bogdanovich, prudemment factuel, est de ne jamais céder à ce miroir aux alouettes que fut Hollywood pour les critiques étrangers. De surcroît, il est si bien informé qu'il se remémore à plusieurs reprises devant leurs réalisateurs ébaubis des films obscurs et encombrants qu'ils feignent d'avoir oublié...
Demeure ce mystère : comment peut-il, ici comme ailleurs, faire si peu de cas dans sa filmographie des Contrebandiers de Moonfleet ? Est-ce parce qu'il fut contraint de le tourner en Cinémascope, "format qui n'est intéressant que pour filmer les serpents et les enterrements" ? Il n'y a plus que le concept glissant de chef d’œuvre involontaire qui puisse raccrocher cette sublime rêverie aux branches de la théorie auctoriale à la française.
Au demeurant, cette politique des auteurs développée par les Cahiers du cinéma, admirable dans ses intentions, reste dans le cadre du cinéma américain une pure chimère. S'appuyant sur une profonde connaissance du fonctionnement des studios, conscient comme Prévert qu'il n'y a rien de plus menteur qu'un générique, le grand atout de Bogdanovich, prudemment factuel, est de ne jamais céder à ce miroir aux alouettes que fut Hollywood pour les critiques étrangers. De surcroît, il est si bien informé qu'il se remémore à plusieurs reprises devant leurs réalisateurs ébaubis des films obscurs et encombrants qu'ils feignent d'avoir oublié...
Avec 150 pages au compteur, Howard Hawks se taille la part du lion. Toute sa filmographie, mineure en apparence et éternelle en profondeur, ne semble être là que pour confirmer le vieil adage hollywoodien : "si vous avez un message à faire passer, utilisez Western Union". Au cinéma, ce sont les petits sujets qui donnent les grandes œuvres. Ainsi des variations hawksiennes autour d'un même dispositif : unité de temps et de lieu, un petit groupe d'hommes, aux professions périlleuses voire létales, soudé par l'amitié et dont l'harmonie sera bousculée par l'irruption d'un personnage féminin. La femme ne sera acceptée - et adoubée par le réalisateur - que si elle adopte les comportements généralement dévolus aux hommes. Rien n'intéresse moins Hawks que le traditionnel gynécée hollywoodien. Sous sa caméra, Bacall explose l'archétype de la femme fatale. Ses portraits féminins figurent parmi les plus singuliers de l'époque : Katherine Hepburn dans L'Impossible Monsieur Bébé ou Rosalind Russell dans La Dame du vendredi, parmi bien d'autres. Sa filmographie est depuis quelque temps un casse-tête pour toutes les gender studies. Hawks, donc, se méfie de l'art et des grands sujets. Si on l'interroge sur Le port de l'angoisse, il s'empresse de préciser qu'il ne sait même pas ce que veut dire "antifasciste". Il se présente comme un pur entertainer. Cela ne l'empêche pas d'embarquer et d'imbiber son ami Faulkner sur tous ses tournages, lequel, entre deux cocktails, rafistole une scène (à ce sujet, lire absolument le désopilant récit de Noël Howard, Hollywood sur Nil). Nouveau démenti à cette légende poisseuse des grands auteurs broyés par Hollywood, extrapolée de la triste fin de Fitzgerald et à laquelle il faudrait faire un sort définitif.
La faconde bienveillante de Hawks vient compenser le laconisme aristocratique de Josef von Sternberg (dont le "von" était toutefois totalement usurpé), pour ce qui est la seule-interview-gag et stérile de l'ouvrage : elle rend palpable tout le désarroi de l'intervieweur au moment de poser ses interminables questions, minutieusement préparées, face à un client mal embouché dont tout l'idiolecte se limite à deux termes : "oui" et "non". Rétif au magnéto, Sternberg avait quoi qu'il en soit déjà réglé tous ses comptes avec Hollywood dans ses mémoires, Fun in a chinese laundry.
L'entretien avec Leo McCarey est le plus poignant. Bogdanovich l'interroge à plusieurs reprises dans sa chambre d'hôpital, sous perfusion, au seuil de la mort. Les deux hommes bravent les interdits médicaux. McCarey, très faible, s'excuse de ne pouvoir répondre avec précision à de nombreuses questions. Aucun auto-apitoiement cela dit : McCarey nous rappelle là qu'il fut aussi l'auteur de Place aux jeunes, ce film si cruel et lucide sur la vieillesse, qui ne put être qu'un four retentissant à sa sortie. Cela n'empêche pas cet échange d'être aussi le plus drôle. McCarey était fait de la même étoffe que l'improbable ménagerie dont il s'occupa au début de sa carrière : c'est lui qui associa Laurel à Hardy, tenta de maîtriser la férocité comique de W.C. Fields et "dirigea" les Marx Brothers dans leur meilleur film, Soupe au canard. Dans son œuvre personnelle, il oscillera toujours entre le drame (les deux versions d'Elle et lui, rare cas d'auto-remake réussi) et le burlesque (Cette sacrée vérité, qui affirma le potentiel comique de Cary Grant), bondieuseries généreuses (La route semée d'étoiles) et mises à sac de toutes les règles de bienséance (dans à peu près tous ses films), toutes ces tendances finissant par s'agglomérer pour former un style unique (seule le passage météorique de Preston Sturges sur la planète cinéma put s'en rapprocher). Sa vie, elle, n'inclinera que vers le mélo : échecs au box-office succédant à un triomphe trop soudain, maccarthysme forcené et destructeur, dépressions, sur-médication, alcoolisme... (à Hollywood, seuls les borgnes dépassent en nombre les alcooliques - les deux phénomènes n'étant pas incompatibles).
Enfin, à la remorque de cet attelage, George Cukor occupe une place un peu à part. Il est encore pleinement en activité au moment de l'entretien (il tournera jusqu'à l'aube des années 80) et ne cède à aucune nostalgie. Distinction sans doute cruciale : il est le seul à ne pas avoir fait ses armes dans le muet. Et pour cause : à l'arrivée des talkies, il fit partie de cette cohorte de metteurs en scène débauchés de Broadway (capables donc de communiquer avec des acteurs qui se sont soudainement mis à parler) et censés prendre la relève des anciens dépassés par le son (on fit l'affront à Ford de lui demander de tourner des courts sonores pour tester ses capacités). Il n'en sera rien et Cukor sera l'un des rares à s'imposer. Car, au contraire, les premiers cinéastes à dompter le parlant et à lui conférer ses lettres de noblesse - après quelques années sinistres, catatoniques, qui faillirent engloutir Hollywood - seront les mêmes qui avaient mené le muet à son apogée : en respectant leur préceptes d'alors (mouvement, soin de l'image), ils ont contenu l'invasion des dialogues et empêché les dramaturges de prendre totalement le pas sur les chefs-opérateurs.
Cukor fera exception. Et pour bien des raisons : intellectuel new yorkais, issu du théâtre, précédé donc d'une réputation de snobinard, juif, homosexuel (ces deux derniers critères lui valurent d'être congédié du tournage d'Autant en emporte le vent à la demande de Clark Gable), on imagine qu'il n'a pas toujours eu la partie facile. Malgré des premiers films empesés, statiques, relevant du plus mauvais théâtre filmé, caractéristiques de cette période de transition, Cukor eut la chance de rencontrer très tôt un gros succès avec What price Hollywood? puis une actrice pour le moins charismatique en la personne de Katherine Hepburn (8 films sous sa direction). C'est évidemment à propos de ses actrices (le listing ahurissant ne ferait que doubler le volume de cet article...) qu'il se montre le plus loquace et le plus chaleureux. Encore épargné par le gâtisme et la nostalgite aiguë, il s'affiche par ailleurs résolument optimiste et plutôt bonne pâte face aux travers d'Hollywood, que ce soit la rigidité des studios de l'ancien temps ou les atermoiements de la génération qui a pris relève.
Cukor fera exception. Et pour bien des raisons : intellectuel new yorkais, issu du théâtre, précédé donc d'une réputation de snobinard, juif, homosexuel (ces deux derniers critères lui valurent d'être congédié du tournage d'Autant en emporte le vent à la demande de Clark Gable), on imagine qu'il n'a pas toujours eu la partie facile. Malgré des premiers films empesés, statiques, relevant du plus mauvais théâtre filmé, caractéristiques de cette période de transition, Cukor eut la chance de rencontrer très tôt un gros succès avec What price Hollywood? puis une actrice pour le moins charismatique en la personne de Katherine Hepburn (8 films sous sa direction). C'est évidemment à propos de ses actrices (le listing ahurissant ne ferait que doubler le volume de cet article...) qu'il se montre le plus loquace et le plus chaleureux. Encore épargné par le gâtisme et la nostalgite aiguë, il s'affiche par ailleurs résolument optimiste et plutôt bonne pâte face aux travers d'Hollywood, que ce soit la rigidité des studios de l'ancien temps ou les atermoiements de la génération qui a pris relève.
Au-delà du mythe, Hollywood fut une pépinière de talents mais, dans son fonctionnement, une sacrée pétaudière qui décourage l'analyse et, dans ses accomplissements, défie toute logique. Le pragmatisme obstiné de Bogdanovich, mâtiné d'une pointe de complaisance, lui a permis d'amasser un inestimable trésor. Avant chaque entretien, ses exposés liminaires regorgent déjà d'observations savoureuses et passionnantes. Sur ce qui a été comme une seconde ruée vers l'Ouest, en se refusant à n'imprimer que la légende, cette somme est à défricher pas à pas, telle une intarissable mine d'or.
Cette large revue d'effectif vient compléter et enrichir les ouvrages de Tavernier et Coursodon sur de semblables territoires. Précisons que l'indispensable Vulgate de ces derniers, 50 ans de cinéma américain, épuisée depuis trop longtemps, devrait bientôt revenir en librairie sous le titre de 100 ans de cinéma américain et malgré le travail colossal à mener, notre impatience est à son comble.
Gageons que le second volume des entretiens de Bogdanovich devrait - restons prudents - nous parvenir avant. Il est annoncé pour avril et réunira un nouvel Olympe : Alfred Hitchcock, Otto Preminger, Sidney Lumet, Robert Aldrich, Don Siegel, Frank Tashlin, Edgar G. Ulmer, Chuck Jones et Joseph H. Lewis.
Cette large revue d'effectif vient compléter et enrichir les ouvrages de Tavernier et Coursodon sur de semblables territoires. Précisons que l'indispensable Vulgate de ces derniers, 50 ans de cinéma américain, épuisée depuis trop longtemps, devrait bientôt revenir en librairie sous le titre de 100 ans de cinéma américain et malgré le travail colossal à mener, notre impatience est à son comble.
Gageons que le second volume des entretiens de Bogdanovich devrait - restons prudents - nous parvenir avant. Il est annoncé pour avril et réunira un nouvel Olympe : Alfred Hitchcock, Otto Preminger, Sidney Lumet, Robert Aldrich, Don Siegel, Frank Tashlin, Edgar G. Ulmer, Chuck Jones et Joseph H. Lewis.
Bibliographie