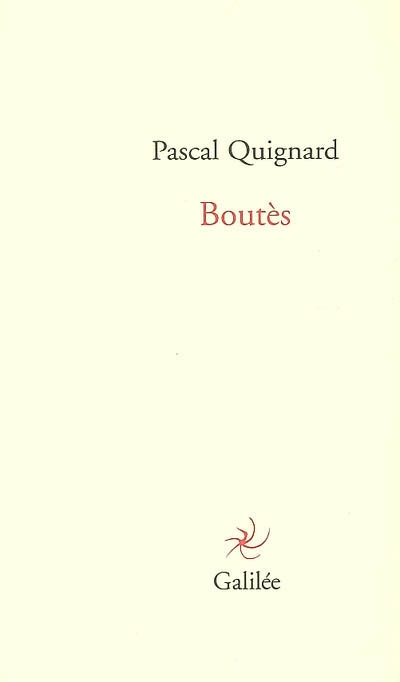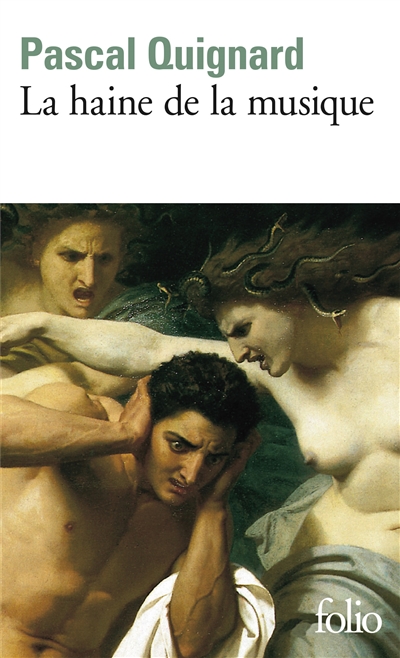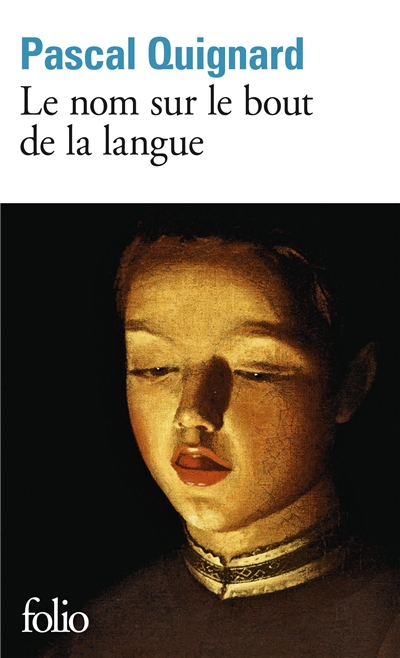Parmi les autres livres disposés sur l'étal de la librairie, c'est le dernier ouvrage de Pascal Quignard qui a attiré vers lui mes regards. L'ouvrage, tel qu'il se présente, intrigue : couverture blanche, pas d'illustration et, si on le retourne, pas non plus de quatrième de couverture. Juste un bandeau sur lequel figurent deux dessins énigmatiques. Mais c'est surtout le titre qui laisse perplexe: Boutès. Ce mot énigmatique n'évoque rien à l'esprit et ne rappelle non plus rien de connu. Certainement un nom propre, se dit-on. Oui, mais dans ce cas, est-ce un lieu? Une personne? Et à quelle langue ce mot appartient-il? Est-ce du latin? Du grec? Lorsqu'on ouvre le livre pour trouver une réponse à ces questions, un prière d'insérer, avec les noms d'Ulysse et d'Orphée, nous apprend que Boutès est un personnage qui appartient à un univers que Quignard affectionne particulièrement, celui de l'antiquité et de la mythologie. C'est pourtant un autre thème cher à l'auteur, la musique, qui est le principal sujet de ce livre, de ce « dernier petit livre voué à la musique » qui est le neuvième à aborder ce thème. C'est un texte bref (pas plus d'une centaine de pages), qui à partir d'un substrat mythologique développe une méditation personnelle sur la musique au sein d'une forme libre, à la fois didactique et poétique, dont je tâcherai de rendre compte au cours de ces quelques pages.
Parmi les autres livres disposés sur l'étal de la librairie, c'est le dernier ouvrage de Pascal Quignard qui a attiré vers lui mes regards. L'ouvrage, tel qu'il se présente, intrigue : couverture blanche, pas d'illustration et, si on le retourne, pas non plus de quatrième de couverture. Juste un bandeau sur lequel figurent deux dessins énigmatiques. Mais c'est surtout le titre qui laisse perplexe: Boutès. Ce mot énigmatique n'évoque rien à l'esprit et ne rappelle non plus rien de connu. Certainement un nom propre, se dit-on. Oui, mais dans ce cas, est-ce un lieu? Une personne? Et à quelle langue ce mot appartient-il? Est-ce du latin? Du grec? Lorsqu'on ouvre le livre pour trouver une réponse à ces questions, un prière d'insérer, avec les noms d'Ulysse et d'Orphée, nous apprend que Boutès est un personnage qui appartient à un univers que Quignard affectionne particulièrement, celui de l'antiquité et de la mythologie. C'est pourtant un autre thème cher à l'auteur, la musique, qui est le principal sujet de ce livre, de ce « dernier petit livre voué à la musique » qui est le neuvième à aborder ce thème. C'est un texte bref (pas plus d'une centaine de pages), qui à partir d'un substrat mythologique développe une méditation personnelle sur la musique au sein d'une forme libre, à la fois didactique et poétique, dont je tâcherai de rendre compte au cours de ces quelques pages.
Un hommage au passé L'ouvrage apparait d'abord comme une promenade parmi les textes et la culture antiques. Le texte fourmille de références, de citations et de noms propres qui sont pour la plupart ceux d'auteurs de l'antiquité. La table des matières, dont tous les chapitres (ou presque) sont autant de noms d'auteurs antiques, donne à lire l'œuvre comme une invitation à la découverte de cette littérature. Boutès est un livre sur les livres, un livre qui trouve son principal aliment dans les livres qui l'ont précédé. L'auteur prend ainsi les allures d'un glossateur ou d'un commentateur, ou c'est du moins ce que donnent à penser l'importance des citations et le nombre des références. Il y a un plaisir manifeste de l'auteur à citer les textes antiques et à se réclamer de leur autorité. La dette envers eux est pleinement assumée par des formules simples et presque scolaires telles que « Apollonios écrit », ou « Timogène a écrit »... Un soin particulier est de même apporté à fournir la référence précise du texte, le livre, le chant, le vers exact. Ainsi en faisant allusion « au vers 200 du chant XII de l'Odyssée d'Homère », ou en citant tel passage « dans Plutarque LXX, 6... » l'auteur fait preuve d'une rigueur quasi-philologique et on l'imagine alors en train de compulser les ouvrages de sa bibliothèque à la recherche du texte précis et de la référence exacte. Ce plaisir de la citation se double d'un goût pour les langues mortes et étrangères, sans que cela handicape la lecture pour autant, la citation étant toujours traduite. Le texte se trouve alors entrecoupé de latin, de grec, d'allemand pour créer une polyphonie linguistique qui confère à l'œuvre une charge poétique supplémentaire. Malgré ce savoir livresque, l'ouvrage n'a rien de fastidieux ni d'agaçant, car si érudition il y a, elle n'est jamais présupposée chez le lecteur mais plutôt offerte comme un objet aimé. Jamais le lecteur ne se sent dérouté ou exclu par l'impressionnante culture dont Pascal Quignard fait preuve car celui-ci possède l'art subtil de la faire partager avec une grande simplicité. Le savoir est ici dépouillé des discours savants et conventionnels dont il est traditionnellement enrobé. L'auteur sait restituer les textes anciens dans leur pureté et dans leur mystère sans prétendre détenir la vérité des œuvres. Boutès se donne donc d'abord à lire comme un hommage et comme une invitation vers une culture pour laquelle l'auteur montre son admiration et son attachement.
La culture dont il est ici question, si elle appartient à un domaine classique par excellence, à savoir l'antiquité gréco-latine, n'en est pas stéréotypée pour autant. Quignard recherche avec assiduité ce qui est laissé dans l'ombre, ce qui est trop méconnu et se donne pour tâche de « faire revivre les choses moins connues que les choses connues »[1]. Il y a une volonté de sortir des sentiers battus du savoir pour parcourir des terrains inexplorés. C'est pourquoi le personnage de Boutès est l'objet central de ce livre, car il est la face cachée de l'un des mythes les plus connus de la mythologie, celui de Jason et les Argonautes. Car si tout le monde connaît Jason, qui connaît Boutès ? C'est un personnage sur lequel on ne sait presque rien et qui se trouve seulement mentionné par quelques rares auteurs. Il s'agit d'une légende pré-homérique, puisque Homère y fait allusion dans l'Odyssée qui est, avec l'Iliade, la plus ancienne œuvre littéraire de l'Europe. Quignard est donc retourné aux plus anciennes racines de notre civilisation pour exhumer ce mythe, remontant à un âge qui précède la naissance de notre monde. A cette volonté de mettre en lumière ce qui est laissé dans l'ombre s'ajoute le fait que Boutès est une figure de dissident. Il est celui qui ne suit pas l'exemple des grands héros fondateurs de notre culture, les Orphée et les Ulysse, et qui se jette à l'eau. Boutès se lève du banc des rameurs, il quitte rang et l'auteur de jouer sur l‘étymologie du mot dissident:
« Sedeo c'est être assis sur son banc. Dis-sedeo c'est se dés-asseoir. Le dis-sident se désassocie du groupe qui ne cherche à accompagner et à domestiquer le solitaire qu'à partir de sa naissance ».
L'on reconnait ici le penchant de l'auteur pour les personnages de marginaux, tel Monsieur de Sainte-Colombe, dans Tous les matins du monde. Cet intérêt pour les personnages de dissidents va de pair avec un regard critique, voire une certaine ironie sur les grandes figures mythologiques : Orphée est celui qui ne peut entendre la véritable musique et qui, armé de son plectre et de sa cithare, la « viole » de son chant et Ulysse tombe dans un certain ridicule, « les mains et les pieds empêtrés dans ses ficelles ». L'auteur ne peut être plus explicite à ce sujet:
« Mais qu'on permette d'oublier un instant ces héros de la pensée occidentale. Qu'on me permette d'oublier Ulysse les mains et les pieds empêtrés dans ses ficelles. Qu'on me permette d'oublier Orphée perdu dans les cordes parallèles de sa cithare qu'il tend, tire, multiplie, accorde. Pendant juste un instant, le temps d'un livre, le temps d'un petit livre, le temps d'un dernier petit livre voué à la musique, je veux faire porter l'attention sur la figure beaucoup plus méconnue qui est celle de Boutès. »
L'on voit ici comme une double attitude de l'auteur face à la culture, un mélange entre l'admiration et une volonté d'aller au-delà. Le savoir atteint ici sa pointe extrême, qui consiste à fouiller ses zones d'ombres pour en faire ressurgir ce qui a été oublié, tout en restant accessible au lecteur.
La forme d'une pensée Il semble impossible de déterminer précisément l'appartenance générique de l'œuvre (et j'avoue ici qu'il m'est impossible de la définir par des termes plus précis). Est-ce un essai? Un traité? Un conte? Un texte autobiographique? Poétique? A la fois aucune et toutes ces formes en même temps. L'ouvrage mêle intrinsèquement tous ces genres à la fois sans qu'il soit possible d'accorder la prééminence à aucun. Dans un autre texte, La Haine de la musique, qui par ses thèmes et par sa forme s'apparente à Boutès, l'auteur avait qualifié les sections de « traités », et l'on se souvient de son désir d'être lu au XVII° siècle. De fait, la forme assertive de la réflexion, la brièveté des phrases, dont le caractère lapidaire évoque parfois une maxime, les nombreux renvois à d'autres textes tiennent de ce genre ancien qu'est le traité. Mais le mot n'apparaît pas ici et par ailleurs, la discontinuité de la réflexion, la liberté de celle-ci soustraient l'œuvre au cadre rigide de ce genre. Le terme d'essai serait peut-être plus approprié, s'il avait gardé le sens que lui a donné Montaigne, à savoir celui d'une écriture de soi et d'une pensée en train de se faire. Car loin d'être une réflexion abstraite et impersonnelle, Boutès se veut une méditation sur des thèmes chers à l'auteur, qui trouvent un écho dans l'ensemble de son œuvre. La présence de l'auteur ponctue en effet le texte, mais cela de manière discrète, par l'emploi occasionnel de la première personne, par de brèves allusions biographiques, par l'apparition du nom de l'auteur dans le dernier chapitre, un peu à la manière d'une signature... Cet entrelacement de l'écriture de soi et de la spéculation intellectuelle peut effectivement rappeler le projet de Montaigne mais le parallèle s'arrête là, car d'autres influences viennent interférer, et notamment celle du conte. Quignard s'était déjà essayé à la forme du conte dans Le Nom sur le bout de la langue, et l'on trouve ici l'insertion de mythes, de fables et d'anecdotes qui trahissent le goût du conte, même s'il ne s‘agit pas là d'inventions originales. Mais s'il est un aspect du texte qui puisse englober les autres et emporter la primauté, ce serait son aspect poétique (le terme étant pris dans son acception la plus large). Car plus qu'une démonstration rigoureuse, c'est un pouvoir de suggestion poétique, un appel à la rêverie que cherche à atteindre le texte par la méditation sur les mythes. L'écriture est également d'une grande force poétique par sa fluidité, sa concision et aussi son incomplétude, qui lui confère son caractère mystérieux et évocateur. Je ne peux alors m'empêcher de citer l'unique phrase du chapitre VI, formidable de densité elliptique: « Thésée oublie de hisser la voile blanche. Alors Egée se jette dans la mer qui devient son nom ».
A cette indétermination générique à visée poétique, se joint une forme libre et discontinue qui semble épouser les mouvements de la pensée. Cela se perçoit au sein même de la division en chapitres: il n'y a entre eux aucune unité de longueur (le premier chapitre comporte une trentaine de pages et le chapitre VIII tient en deux lignes) ni non plus de lien logique apparent. Chacun commence ex abrupto, sans que le rapport avec les chapitres précédents ne soit explicité. Les thèmes, les images, les récits se mettent en place petit à petit, puis se raccordent les uns aux autres, rétrospectivement, au fur et à mesure de la lecture. Aussi bien entre les chapitres qu'entre les phrases, l'auteur prend soin de gommer les chevilles du discours et de travailler la discontinuité, procédé caractéristique de son style. Cela donne l'impression d'une pensée discontinue, qui procède par fulgurances, par éclairs successifs (on remarquera que l'image de l'éclair apparaît au chapitre IX). De là l'omniprésence des phrases interrogatives qui fonctionnent comme les aiguillons stimulant la pensée et qui sont aussitôt suivies d'une réponse instantanée. Le plaisir du lecteur est donc d'assister à une pensée qui avance par à-coups, à une réflexion en exercice, comme si le texte échappait à tout schéma préconçu et s'écrivait sous les yeux du lecteur en obéissant seulement au cheminement flottant et irrégulier de la pensée.
Ce n'est pourtant pas le cas et cette impression de spontanéité est le fruit d'une composition élaborée, destinée à motiver la lecture et à donner au lecteur un rôle dans la construction du sens. Le texte est volontairement lacunaire, il y a un travail de l'auteur sur les ruptures logiques, les silences, les ellipses et c'est alors au lecteur de trouver le fil d'Ariane, de reconstituer les réseaux d'images et de significations, de combler ou d'interpréter les blancs du texte. Sans être abscons, le texte n'en demande pas moins un travail d'herméneutique. A plusieurs reprises la réflexion ou le récit sont laissés en suspens, sans conclusion, afin de laisser l'espace ouvert à la méditation du lecteur. C'est par exemple le cas du chapitre XVI, constitué d'une seule et unique phrase: « A Vienne, en 1828, se sentant mourir, juste trois semaines avant qu'il rendît le souffle, Schubert alla se recueillir sur la tombe de Haydn dans la Memoria de la Bergkirche. » Le fait nous est livré dans son objectivité historique et impersonnelle, sans autre développement de la part de l'auteur. Au lecteur de méditer là-dessus. De même, le dernier chapitre, laissé en suspens avec l'image de la serviette qui pend à un clou, suggère l'inachèvement plus qu'il n'apporte une conclusion car, de toute évidence, le propos de l'auteur n'est pas d'apporter une conclusion mais au contraire de laisser le texte ouvert, riche de son caractère énigmatique.
La musique et la mort L'auteur définit lui-même Boutès comme un « petit livre voué à la musique », thème qui hante toute l'œuvre de Quignard. Boutès peut d'ailleurs, par sa forme et par son sujet, rappeler d'autres œuvres de l'auteur et notamment La Haine de la musique, qui entendait étudier les rapport que la musique entretient avec la souffrance. Dans Boutès, Quignard poursuit sur cette lignée et en pousse plus loin la portée car il s'agit cette fois d‘une réflexion sur le lien entre la musique et la mort qui s'articule autour du mythe de Boutès. On ne peut comprendre ce lien qu'à partir de la distinction que l'auteur opère entre deux types de musique: une musique dévoyée, artificielle et la musique véritable, celle dont il est question dans Boutès. La légende de Boutès illustre ce caractère mortifère de la musique véritable, cette musique étant incarnée par les sirènes, monstres mi-femmes, mi-oiseaux, qui dévorent les marins qu'elles attirent sur le rivage par leur chant. Ici Quignard renverse le mythe et sous sa plume les sirènes passent de l'état de monstre anthropophage à celui d'incarnation de la musique. La figure mythologique de la sirène synthétise les aspects que revêt la musique véritable aux yeux de l'auteur: à la fois femme et animal, désir et mort. La musique est féminine, et par conséquent désirable (l'auteur revient à plusieurs reprises sur l'image des seins), mais elle est à moitié oiseau, animale et donc carnassière, et le motif des oiseaux, que l'on trouve à plusieurs reprises, va de pair avec la mort. La musique est alors un curieux mélange de désir et de mort. Elle exerce une attraction irrépressible qui ne s'accomplit que dans la mort, voire au-delà de la mort. C'est là la pointe extrême de la réflexion de Quignard: la musique n'appelle pas tant à la mort qu'à un retour à l'avant-vie. Elle est en ce sens mère tout autant que femme et l'image des seins des sirènes peut aussi bien être comprise comme un objet du désir que comme un symbole de la maternité. Ainsi se jeter à la mer, comme le fait Boutès, c'est chercher à rejoindre un état prénatal bienheureux. On touche ici au mythe biblique du paradis perdu. La véritable musique réveille en nous comme un état pré-utérin, idyllique, qui ne peut être retrouvé que dans la mort, et c'est pourquoi elle est à ce point source de douleur. L'écoute de la musique est une expérience terrible en ce qu'elle réveille en nous un bonheur enfoui et perdu à jamais : c'est la définition même de la nostalgie, étymologiquement la douleur du retour. La musique est donc une expérience qui remue les profondeurs de l'être et réduit l'homme à sa propre douleur. Dans la musique l'homme est ramené au tête-à-tête avec lui-même dans une expérience intensément solitaire: c'est Boutès qui se désolidarise du groupe des rameurs pour se jeter à la mer et c'est l'aveu de l'auteur de ne pouvoir écouter la musique que seul. Ni Orphée ni Ulysse ne sont capables de se laisser aller à l'appel de la musique originelle, seul Boutès se jette à la mer, et c'est la cause de la fascination qu'exerce sur l'auteur ce personnage qui cristallise sa pensée sur la musique.
Si l'œuvre est savamment organisée en un réseau dense et subtil d'images, d'échos et de parallelismes, elle ne constitue en aucun cas un système clos et replié sur lui-même. Il ne faudrait pas réduire Boutès à une réflexion abstraite sur la musique qui n'aurait de valeur que dans l'espace textuel. Quignard semble chercher une explication, qui passe par la culture et le mythe, au sentiment indéfinissable que procure la musique que l'on aime, ici représentée par la figure de Schubert (c'était Sainte-Colombe dans Tous les matins du monde). Il y a également une certaine nostalgie qui se dégage à la lecture, notamment dans le dernier chapitre et dont l'objet incertain semble lié au manque et à l'absence d'une femme mystérieuse, qui n'est peut-être autre que la musique à laquelle l'auteur a tourné le dos dans sa jeunesse. Mais au-delà de ces implications biographiques, l'œuvre garde tout son pouvoir sur le lecteur. C'est une invitation à la rêverie, un espace ouvert à l'imagination qui modifie profondément le regard que l'on porte sur le mythe et l'oreille que l'on tend à la musique. Mais la principale qualité de l'œuvre est certainement sa capacité à ne pas être épuisée par une seule lecture et à faire naître le désir de la relecture, ce qui constitue, à mon sens, le premier critère de réussite d'une œuvre littéraire.
- Thomas Pandellé