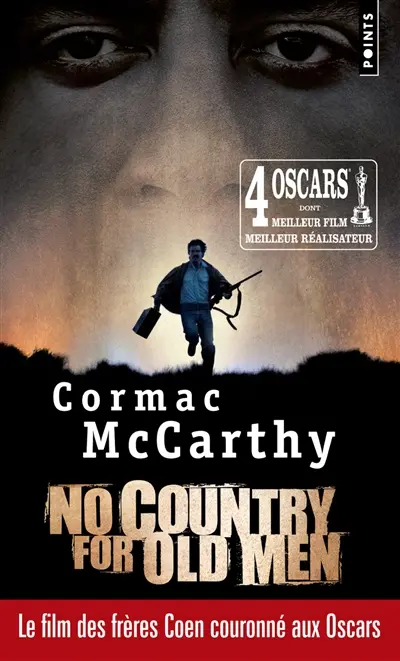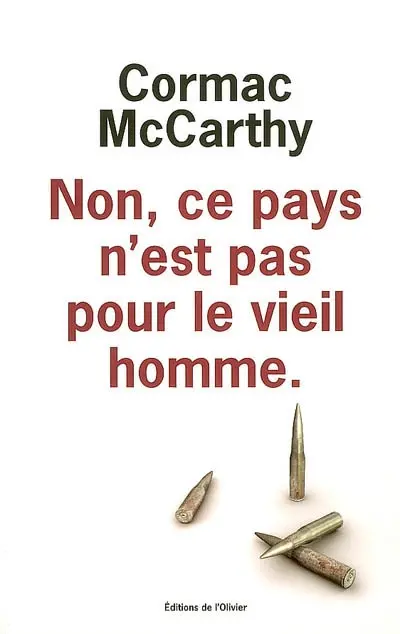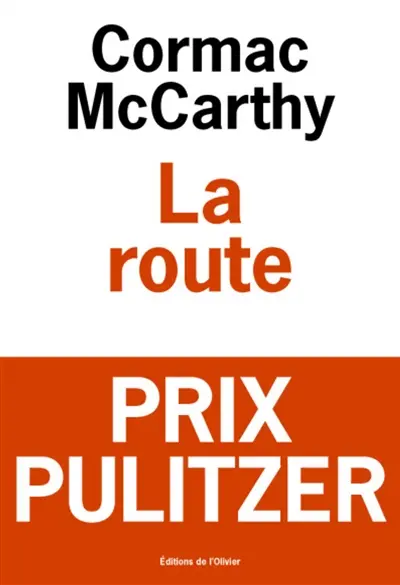Cormac McCarthy a suscité un intérêt renouvelé en cette année 2008. Unanimement encensé par la critique avec son précédent roman Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, paru en 2006 et adapté au cinéma en janvier dernier par Joel et Ethan Coen sous le titre « No Country For Old Men », le romancier américain s'est vu récompenser du prix Pullitzer en 2007 pour son dernier roman intitulé La route, paru en traduction en France en même temps que le film. Dans les cendres d'un monde ruiné par une tragédie qui restera inconnue, un homme et son jeune fils semblent compter parmi les seuls survivants. Ils avancent péniblement vers un objectif trouble (le Sud et la chaleur) et doivent faire face à la faim, à la fatigue, au froid et surtout à la barbarie des autres hommes. Malgré le succès médiatique et commercial autour du « produit McCarthy », j'ai pu entendre certaines voix de lecteurs s'élever contre ce qu'ils nomment « l'aura de conservatisme, de morale et de prophétisation » qui plane sur ce dernier roman. Qu'elles soient élogieuses ou non, les très nombreuses réactions à La route se condensent globalement autour de trois considérations essentielles : la narration, qui choque par l'aspect apparemment très « dépouillé » de l'écriture, se déploie à travers une ambiance des plus sombres soutenue par le pessimisme ambiant du récit. Fort d'un recul de pratiquement une année, j'aimerais revenir aujourd'hui sur cette réception.
Western, polar, fable biblique, récit initiatique : McCarthy aime puiser dans toutes les ressources à sa disposition. La route semble d'ailleurs tenir la réplique à de nombreux films ou romans cultes qui l'ont précédé. On pense notamment, bien qu'elle se situe dans un tout autre registre, à la saga Mad Max : les hommes sont revenus à la brutalité, le système est régi par la force, les ressources disparaissent. C'est que McCarthy s'est ici imposé un thème éminent de la science-fiction comme cadre de son récit : l'univers post-apocalyptique. Sa principale originalité est sans doute de n'avoir pas concédé à décrire, à expliquer ni même à simplement dater cette fin du monde. Celle-ci est, par contre, reconstituée, fragment après fragment, par le personnage du père, unique rescapé à la mémoire encore vive et témoin muet de l'ancien monde : dans un futur plus ou moins proche, tous les êtres vivants sont morts, végétaux comme animaux, tandis que le monde en ruines et privé de son soleil est désormais entièrement recouvert de cendres. Malgré cet emprunt apparent à l'univers de la science-fiction, le sujet et les thèmes sont universels. Comme l'avance Nathalie Crom, dans Télérama, « McCarthy est hanté par la violence des hommes et la question du Mal. » Aux origines, La route semble avant tout se situer dans un dialogue avec la Bible. Quel sens donner à la morale, aux valeurs, quelle dignité restituer à l'homme tandis que le monde semble marcher sur la tête ? La violence de La route, poignante, pure, brutale, coïncide avec ces reportages sur la guerre au Congo que l'on peut voir dans le deuxième quart d'heure des actualités. C'est là, de tout temps, la barbarie ; demain, hier, et au Congo aujourd'hui. Bien chevillée à l'homme, nous rappelle McCarthy, il y a, toujours, ce problème de la conscience. Pourquoi y a-t-il des êtres qui ont une conscience, une intelligence humaine et morale, un sens de la limite, de la douceur et de la bonté, et d'autres non ? Des hordes d'individus qui vivent dans l'insouciance de leurs atteintes et de leurs crimes ? Qui se vautrent, sans être en mesure de se juger d'abord eux-mêmes ? Dans Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, le ton est déjà donné : le temps n'est plus aux valeurs humanistes honnêtement assumées. Le sherif qui les incarne est un vieux réactionnaire. Mais plus encore que de simplement les prêcher, il s'agit bien ici d'en éprouver les limites jusque dans son être, à travers une expérience extrême et éprouvante, une trajectoire balisée par la seule et ô combien fragile certitude de faire ce qui est juste. Il s'agit bien encore non pas de les clamer mais de les transmettre, ou plutôt d'avoir encore la volonté d'oser les transmettre. Déjà présente dans son précédent roman, la métaphore de la filiation, de l'éducation et de la protection est ici reprise à travers la figure de la flamme. A la base de leur complicité, le père et le fils savent qu'ils sont là pour « porter le feu » et qu'ils sont d'ailleurs « les seuls à pouvoir le faire ». Symbole ambivalent d'espoir mais aussi de la divinité suprême et de l'orgueil prométhéen, de ce « Verbe » divin que l'écrivain lui-même lègue à son propre fils John Francis en tête du roman.
Cormac McCarthy a suscité un intérêt renouvelé en cette année 2008. Unanimement encensé par la critique avec son précédent roman Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, paru en 2006 et adapté au cinéma en janvier dernier par Joel et Ethan Coen sous le titre « No Country For Old Men », le romancier américain s'est vu récompenser du prix Pullitzer en 2007 pour son dernier roman intitulé La route, paru en traduction en France en même temps que le film. Dans les cendres d'un monde ruiné par une tragédie qui restera inconnue, un homme et son jeune fils semblent compter parmi les seuls survivants. Ils avancent péniblement vers un objectif trouble (le Sud et la chaleur) et doivent faire face à la faim, à la fatigue, au froid et surtout à la barbarie des autres hommes. Malgré le succès médiatique et commercial autour du « produit McCarthy », j'ai pu entendre certaines voix de lecteurs s'élever contre ce qu'ils nomment « l'aura de conservatisme, de morale et de prophétisation » qui plane sur ce dernier roman. Qu'elles soient élogieuses ou non, les très nombreuses réactions à La route se condensent globalement autour de trois considérations essentielles : la narration, qui choque par l'aspect apparemment très « dépouillé » de l'écriture, se déploie à travers une ambiance des plus sombres soutenue par le pessimisme ambiant du récit. Fort d'un recul de pratiquement une année, j'aimerais revenir aujourd'hui sur cette réception.
Western, polar, fable biblique, récit initiatique : McCarthy aime puiser dans toutes les ressources à sa disposition. La route semble d'ailleurs tenir la réplique à de nombreux films ou romans cultes qui l'ont précédé. On pense notamment, bien qu'elle se situe dans un tout autre registre, à la saga Mad Max : les hommes sont revenus à la brutalité, le système est régi par la force, les ressources disparaissent. C'est que McCarthy s'est ici imposé un thème éminent de la science-fiction comme cadre de son récit : l'univers post-apocalyptique. Sa principale originalité est sans doute de n'avoir pas concédé à décrire, à expliquer ni même à simplement dater cette fin du monde. Celle-ci est, par contre, reconstituée, fragment après fragment, par le personnage du père, unique rescapé à la mémoire encore vive et témoin muet de l'ancien monde : dans un futur plus ou moins proche, tous les êtres vivants sont morts, végétaux comme animaux, tandis que le monde en ruines et privé de son soleil est désormais entièrement recouvert de cendres. Malgré cet emprunt apparent à l'univers de la science-fiction, le sujet et les thèmes sont universels. Comme l'avance Nathalie Crom, dans Télérama, « McCarthy est hanté par la violence des hommes et la question du Mal. » Aux origines, La route semble avant tout se situer dans un dialogue avec la Bible. Quel sens donner à la morale, aux valeurs, quelle dignité restituer à l'homme tandis que le monde semble marcher sur la tête ? La violence de La route, poignante, pure, brutale, coïncide avec ces reportages sur la guerre au Congo que l'on peut voir dans le deuxième quart d'heure des actualités. C'est là, de tout temps, la barbarie ; demain, hier, et au Congo aujourd'hui. Bien chevillée à l'homme, nous rappelle McCarthy, il y a, toujours, ce problème de la conscience. Pourquoi y a-t-il des êtres qui ont une conscience, une intelligence humaine et morale, un sens de la limite, de la douceur et de la bonté, et d'autres non ? Des hordes d'individus qui vivent dans l'insouciance de leurs atteintes et de leurs crimes ? Qui se vautrent, sans être en mesure de se juger d'abord eux-mêmes ? Dans Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, le ton est déjà donné : le temps n'est plus aux valeurs humanistes honnêtement assumées. Le sherif qui les incarne est un vieux réactionnaire. Mais plus encore que de simplement les prêcher, il s'agit bien ici d'en éprouver les limites jusque dans son être, à travers une expérience extrême et éprouvante, une trajectoire balisée par la seule et ô combien fragile certitude de faire ce qui est juste. Il s'agit bien encore non pas de les clamer mais de les transmettre, ou plutôt d'avoir encore la volonté d'oser les transmettre. Déjà présente dans son précédent roman, la métaphore de la filiation, de l'éducation et de la protection est ici reprise à travers la figure de la flamme. A la base de leur complicité, le père et le fils savent qu'ils sont là pour « porter le feu » et qu'ils sont d'ailleurs « les seuls à pouvoir le faire ». Symbole ambivalent d'espoir mais aussi de la divinité suprême et de l'orgueil prométhéen, de ce « Verbe » divin que l'écrivain lui-même lègue à son propre fils John Francis en tête du roman.
La route est une œuvre ambitieuse comme on en fait peu, comme on n'en fait plus. Elle tente l'impossible pirouette d'une narration à la fois épique et pertinente. Bien que le récit soit le théâtre d'une expérience qui culmine au comble de l'insoutenable, le regard pénétrant et juste de McCarthy évite l'écueil de l'indécence. Dans un monde privé de Dieu qui m'évoque très clairement Beckett (« il n'y a pas de Dieu et nous sommes ses prophètes », page 147), les hommes en sont réduits à leurs fonctions biologiques essentielles, à ramper misérablement près du sol : le père, courbé et à bout de forces, pousse et traîne un caddie aussi fatigué que lui sur des kilomètres, avec une lenteur maladive à laquelle McCarthy donne une consistance très concrète. Chaque action est décortiquée et énoncée comme si elle pouvait être la dernière avant l'extinction. Livrés aux mains d'un destin désormais aveugle, les hommes en sont réduits à s'entre-dévorer. Mais McCarthy n'est pas Beckett et le marcheur refuse de s'interroger sur le sens d'une existence privée de toute perspective d'avenir, vidée de tout sens et s'obstine à marcher - vers rien. Ce n'est pas tant l'épreuve d'une existence arrivée à son terme qui fascine le romancier américain que la cristallisation, à travers un parcours aussi laborieux qu'incroyablement douloureux, de ce qui fait que l'homme est (et reste) un homme. La finesse et la pertinence du regard de McCarthy tient, en cela, à ce qu'il ne se positionne jamais vis-à-vis de ses protagonistes. L'univers postapocalyptique qu'il a créé doit être, selon moi, envisagé comme une focale visant à dégager, à travers la purge opérée par la dépossession totale de l'homme, ce qui constitue celui-ci en propre. Le propre de « l'humain », selon McCarthy, se tient dans ses valeurs. Ou plutôt ici à l'écho lointain de ces valeurs auquel les derniers élans de dignité empêchent désespérément de renoncer. Tandis que le monde lui-même (on n'ose murmurer le nom de Dieu) semble vouloir vous mettre à l'épreuve, il s'agit de s'obstiner à raviver la « flamme ». Il ne me semble pas pertinent de réduire l'univers post-apocalyptique de La route à une parabole prophétique sur la décadence moderne et l'inexorable chute de l'homme. C'est un cadre qui vaut surtout pour son incroyable force de fascination. Un cadre dérangeant à travers lequel McCarthy peut aisément figurer une humanité aussi tourmentée que brûlante du désir de vivre et de persister jusque dans l'abandon (la femme du personnage principal), la barbarie (la plupart des hommes rescapés et devenus cannibales) ou l'errance. Dans tous les cas, la voix du narrateur se veut toujours la plus détachée possible malgré une identification récurrente et forte avec le point de vue du père : on partage tout de même ses pensées ainsi que ses souvenirs et ses rêves. On sent un réel désir chez le romancier de bâtir des personnages crédibles, travail de projection d'autant plus difficile qu'il se place dans un univers de science-fiction où la « lourdeur » est aisée. Ici, pas de prophète échevelé qui crierait : « je vous l'avais bien dit ! ». Pas non plus d'indéfectible certitude de faire le Bien et de savoir ce qu'il est ; ni même d'ailleurs de connaissance ou d'intérêt profond vis-à-vis de ce qu'est le Bien. McCarthy situe les ultimes élans d'humanité dans l'amour inconditionnel entre un père et son fils. Garants respectifs de la vie de l'autre, ils sont surtout les garants réciproques de leur humanité. A plusieurs reprises, c'est le fils qui encourage le père à la pitié et à la compassion dans un monde qui ne devrait plus en présenter. Pourtant, c'est bien grâce à l'éducation attentionnée de son père que « le petit » est devenu l'être humain qu'il est devenu. Dans les derniers instants du roman, lorsque son père meurt, cet amour envers celui qui n'est encore qu'un enfant sera relayé par la présence féminine qui l'accueille dans son nouveau foyer. Dans La route, les derniers sursauts de Bien et de morale sont synthétisés dans les rapports entre ce père et son fils : rapports réduits au minimum, aux gestes de survie les plus essentiels, à des échanges d'autant plus touchants qu'ils suggèrent ce qu'ils ne peuvent pas affronter - la peur, la perte de soi, le désespoir, la mort. Malgré les apparences, la langue de McCarthy est ici loin d'être « imprécise ». Elle évoque au contraire des images d'autant plus nettes qu'elles font référence (en creux) à la détresse physique et morale de ce duo malgré tout uni par une complicité qui se passe des mots. La structure des dialogues, de même que la structure du roman est ainsi entièrement modulée autour de cette évocation.
Difficile de commenter l'action de La route car les repères spatio-temporels y sont complètement brouillés. De même que les personnages - le père se repère avec des morceaux de cartes déchirés et complètement illisibles - sont complètement perdus et livrés à leurs instincts d'exploration les plus primaires tandis que la faim les tenaille, McCarthy déjoue les repères habituels censés baliser la narration d'un récit. Le seul et unique repère, le plus imprécis et le moins « respecté », oserais-je avancer, dont use et abuse McCarthy est la très minimale conjonction de coordination « et », parfois répétée sans aucune retenue dans une seule et même phrase. L'usage de cette conjonction, même s'il doit être relativisé car nettement plus fréquent en langue anglaise, n'est pas anodin. Les signes de ponctuation sont abolis : les tirets des dialogues sont absents et soulignent cette perte de repères ; de toute façon, les dialogues sont rares, ils matérialisent bien trop la peur. Le livre ne présente de même aucune subdivision en chapitres. La structure du roman est celle des tableaux successifs, de longueur très variables allant de quelques lignes à quelques pages. Chaque « strophe » présente ainsi une liaison logique quelconque mais pas nécessairement spatio-temporelle avec les strophes qui l'entourent. On assiste à la fois dans la langue et dans la narration à de nombreuses redites, à des imprécisions ou encore à des scènes dont le sens mystérieux n'est parfois révélé que beaucoup plus tard, voire pas du tout. De nombreux points de vue sont volontairement passés sous silence ou laissés dans le flou : l'enfant est-il né un peu avant, pendant ou peu après l'apocalypse ? dans tous les cas, comment se fait-il qu'il puisse lire ? Pourquoi le monde est-il recouvert de cendres ? Comment les personnages présentés dans le roman ont-ils survécu à cette apocalypse ? Sans aller dans le détail, on note par exemple l'absence de noms pour tous les personnages. En l'absence de Dieu, ils n'ont que faire d'un nom. De toute façon, ils ne s'interpellent pas entre eux, même dans les situations les plus dangereuses : ils se mettent à se parler puis s'interrompent. Simplement. D'après l'aperçu qu'en donne la traduction, la langue de McCarthy, si « simple » soit-elle, n'en est pas moins incisive. Elle se fait même parfois mélodieuse, travaillée jusque dans ses rythmes et ses sonorités. D'ailleurs, la chose n'est sans doute pas anodine : la traduction de La route par François Hirsch évoque très clairement le style de la Bible - les verbes d'action se succèdent ; on évite soigneusement tout écart psychologique. Lorsque l'enfant « pleure » la mort de son père : « Il était enveloppé dans une couverture comme l'homme l'avait promis et le petit ne le découvrit pas mais il s'assit à côté de lui et se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Il pleura longtemps. » ; page 244. La répétition du verbe pleurer favorise un effet pathétique sous les aspects réservés du simple compte-rendu de faits. Cette simplicité « polie » et pudique contribue à l'alchimie particulière de la langue déployée par McCarthy - une langue pleine de références qui désigne « en seconde main » plus qu'elle ne décrit à proprement parler. Le critique américain Harold Bloom fait de Cormac McCarthy l'un des quatre plus grands romanciers américains de son temps avec Philip Roth, Thomas Pynchon et Don DeLillo. Après dix ans de silence, on ne reprochera certainement pas à McCarthy son retour à la publication. Sous ses abords désincarnés, La route est un roman qui restitue son « âme » et sa flamme à l'humanité, à travers un itinéraire aussi effroyable que fascinant. C'est cependant une œuvre austère dont il faut comprendre le propos malgré une indéniable aura de conservatisme et de morale. Les « méchants » sont certes de vrais monstres mais les « gentils » sont décrits avec une telle sincérité et une telle retenue qu'on ne peut au minimum que saluer l'élégance d'un grand écrivain.
Cédric Lafferrière
Bibliographie : McCarthy, Cormac, La route, Editions de l'Olivier, 2008.