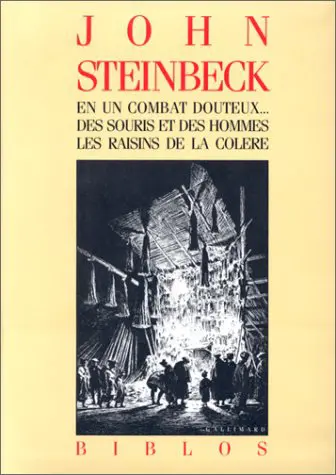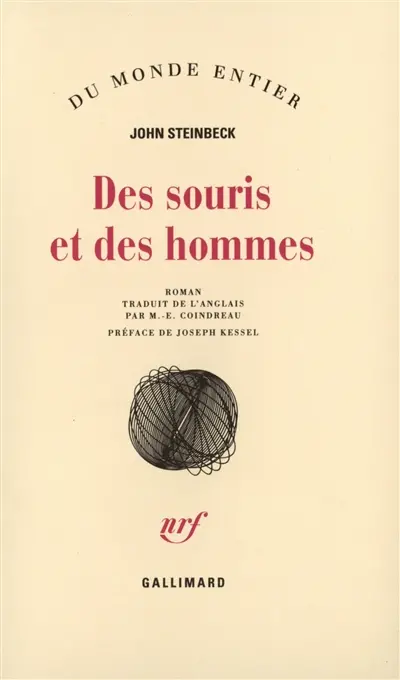Chargement...
Chargement...
Des souris et des Hommes

Publié le
22/06/2020
Des souris et des Hommes de John Steinbeck
C’est une histoire d’hommes, d’amitié, et de rêves. Comme tant d’autres finalement.
C’est John Steinbeck qui, comme à son habitude, nous promène à travers son appareil photo dans une Amérique tout aussi cassée que ceux qui l’occupent.
Et, oui, c’est aussi un peu une histoire de souris.
Dans cette œuvre, rien de ce que vous connaissez. Vous rencontrerez des hommes, une femme oui, mais des hommes surtout, et tout ce qu’ils ont à vous raconter passera par leurs gestes et leurs paroles. Comme le reporter de guerre caché derrière son appareil, vous allez observer les ranchs de Californie et leurs résidants, en témoin privilégié. En spectateur plutôt, car avec Steinbeck, c’est aussi une histoire de théâtre, et en bon metteur en scène, il vous laisse avec une facilité déconcertante apercevoir le ciel de Californie, les arbres, le feu de camp et le ruisseau qui s’écoule. Et alors, une fois le décor installé, les lumières s’éteignent, le calme se fait dans la salle, et les acteurs entrent en scène.
La première fois qu’on rencontre George, il est nerveux, un peu tendu, assez dur et réservé, il n’inspire pas tellement la sympathie le bougre. La première fois qu’on rencontre Lennie, il est grand et joyeux, et il est toujours comme ça, vous allez voir. Enfin presque. Quand on les voit tous les deux, ça colle bien, c’en est caricatural. On croirait voir un conte pour enfant mais eux sont en crise : dehors c’est la Grande Dépression, et ils sont à la rue. Oui nous sommes bien sous le soleil de Californie mais, à cette époque, il donne plus la chair de poule qu’un bronzage hollywoodien. Vous l’apprendrez assez tôt mais il s’est passé quelque chose juste avant le lever de rideau, comme toujours dans les bonnes histoires, un événement qui a conduit le duo où nous les rencontrons au début, au bord de la Salinas.
George brise le silence le premier, c’est un homme de tête, vous verrez, il entreprend, donne les ordres, et surtout, fidèle à son époque, il jure comme un charretier. Vous étiez prévenus, si l’écriture de Steinbeck coule comme la rivière, ce sont les personnages qui prennent la parole et font tourner la baraque, et nom de Dieu ça décape. Avec eux pas de politesses ou de belles syntaxes, ici ça y va d’argot en insultes, de pourritures en pourritures. A l’image de leur créateur, ils se passent de dentelles et d’ornements, ils sont directs, francs, sincères, et ça fait un bien fou. Ils ne passeront pas par quatre chemins pour vous dire qu’ils sont plus pauvres que pauvres et qu’ils aimeraient bien avoir un peu de sous pour se payer une pute de la ville le week-end. Ils ne tourneront pas autour du pot pour vous dire que le travail se fait rare par ici et que pour ces deux bougres-là il est encore plus difficile d’en garder un longtemps, de travail. Et ça y est, c’est encore plus vrai, on y est près de la rivière, on est dans le champs avec eux. Et c’est magique.
Vous ne saurez rien de l’intrigue ici. Tout ce que vous devez savoir, c’est que ce duo vaut le détour. Leur histoire vaut le détour.
C’est John Steinbeck qui, comme à son habitude, nous promène à travers son appareil photo dans une Amérique tout aussi cassée que ceux qui l’occupent.
Et, oui, c’est aussi un peu une histoire de souris.
Dans cette œuvre, rien de ce que vous connaissez. Vous rencontrerez des hommes, une femme oui, mais des hommes surtout, et tout ce qu’ils ont à vous raconter passera par leurs gestes et leurs paroles. Comme le reporter de guerre caché derrière son appareil, vous allez observer les ranchs de Californie et leurs résidants, en témoin privilégié. En spectateur plutôt, car avec Steinbeck, c’est aussi une histoire de théâtre, et en bon metteur en scène, il vous laisse avec une facilité déconcertante apercevoir le ciel de Californie, les arbres, le feu de camp et le ruisseau qui s’écoule. Et alors, une fois le décor installé, les lumières s’éteignent, le calme se fait dans la salle, et les acteurs entrent en scène.
La première fois qu’on rencontre George, il est nerveux, un peu tendu, assez dur et réservé, il n’inspire pas tellement la sympathie le bougre. La première fois qu’on rencontre Lennie, il est grand et joyeux, et il est toujours comme ça, vous allez voir. Enfin presque. Quand on les voit tous les deux, ça colle bien, c’en est caricatural. On croirait voir un conte pour enfant mais eux sont en crise : dehors c’est la Grande Dépression, et ils sont à la rue. Oui nous sommes bien sous le soleil de Californie mais, à cette époque, il donne plus la chair de poule qu’un bronzage hollywoodien. Vous l’apprendrez assez tôt mais il s’est passé quelque chose juste avant le lever de rideau, comme toujours dans les bonnes histoires, un événement qui a conduit le duo où nous les rencontrons au début, au bord de la Salinas.
George brise le silence le premier, c’est un homme de tête, vous verrez, il entreprend, donne les ordres, et surtout, fidèle à son époque, il jure comme un charretier. Vous étiez prévenus, si l’écriture de Steinbeck coule comme la rivière, ce sont les personnages qui prennent la parole et font tourner la baraque, et nom de Dieu ça décape. Avec eux pas de politesses ou de belles syntaxes, ici ça y va d’argot en insultes, de pourritures en pourritures. A l’image de leur créateur, ils se passent de dentelles et d’ornements, ils sont directs, francs, sincères, et ça fait un bien fou. Ils ne passeront pas par quatre chemins pour vous dire qu’ils sont plus pauvres que pauvres et qu’ils aimeraient bien avoir un peu de sous pour se payer une pute de la ville le week-end. Ils ne tourneront pas autour du pot pour vous dire que le travail se fait rare par ici et que pour ces deux bougres-là il est encore plus difficile d’en garder un longtemps, de travail. Et ça y est, c’est encore plus vrai, on y est près de la rivière, on est dans le champs avec eux. Et c’est magique.
Vous ne saurez rien de l’intrigue ici. Tout ce que vous devez savoir, c’est que ce duo vaut le détour. Leur histoire vaut le détour.
Bibliographie